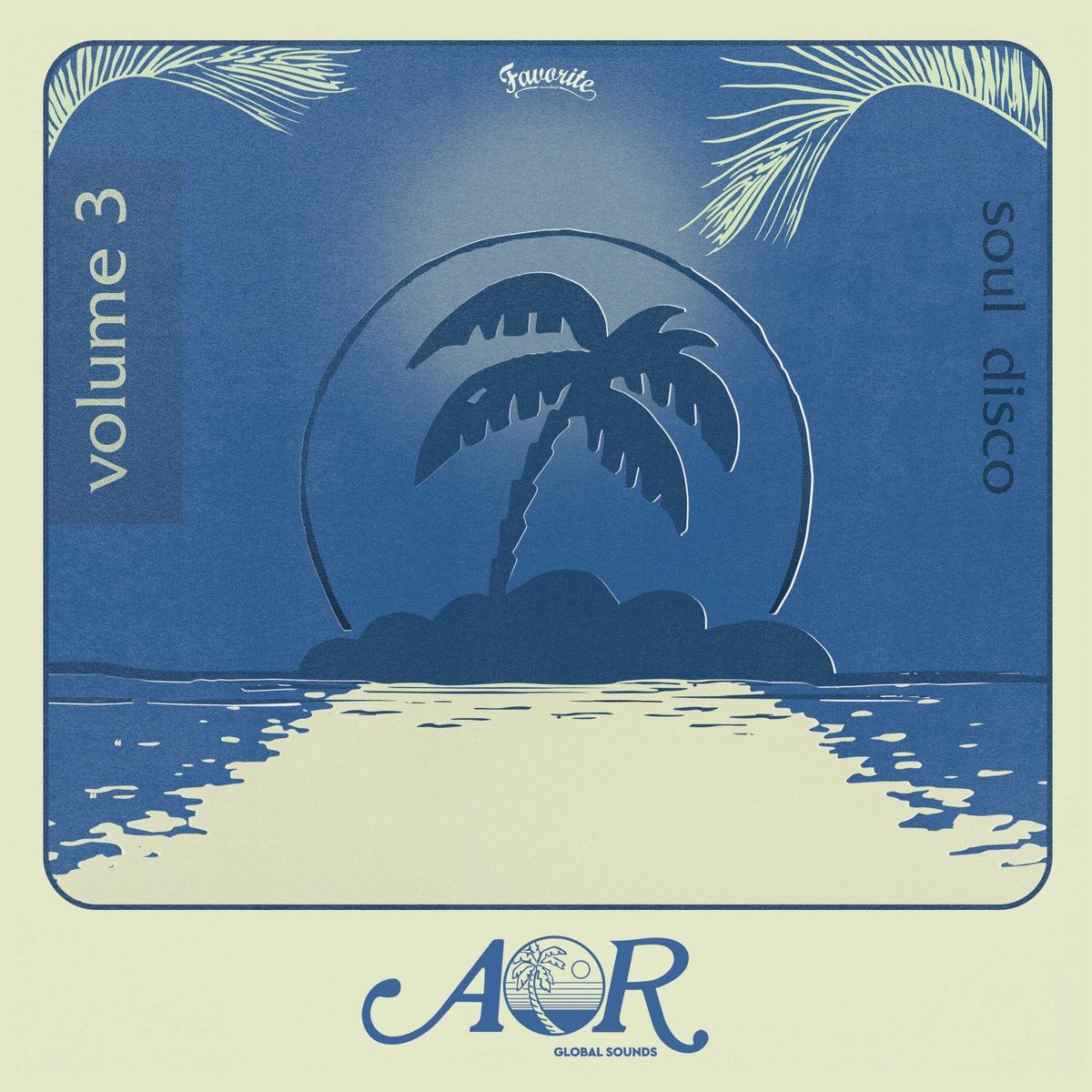Cet article s’inscrit dans une nouvelle offre édito que nous souhaitons développer tout au long de l’année : des formats plus longs, qui prennent le temps de s’atteler à un sujet plus vaste, sans précipitation mais avec passion. Parce que les sorties s’accumulent à une vitesse indécente, il est parfois bon de faire un pas de côté : envisager un disque dans un contexte plus large par exemple, ou s’attarder sur une scène locale bouillonnante, ici comme à l’autre bout du monde. Prendre le temps. Discuter & ausculter un genre, un artiste, un sujet global, une époque, un club, une ville, hors calendrier de sorties ou d’événements. Prendre le temps, tout simplement.
Après avoir fait un détour par le Japon, puis la ville de Sheffield et son fleuron électronique CPU, retour à Paris et avec la manière : cette semaine, nous nous plongeons dans le catalogue du plus chaud d’entre nous, Favorite Recordings ! Entre rééditions french boogie, compilations AOR & albums funk, le label parisien semble avoir un temps d’avance sur nos goûts, nos envies & même le soleil. Nous allons voir & surtout écouter, toute la semaine, ce qui fait Favorite Recordings.
Sans plus d’introduction que nécessaire, nous avons échangé avec Pascal Rioux, fondateur & DA du label. Un entretien au long cours, entre petites & grandes histoires, économie du disque & rencontres, réédition & bêtes de studio. Direction le groove.
Vous avez enregistré, produit & sorti le premier LP d’Aldorande cet été. Ces enregistrements en studio, comment est-ce que ça se passe ?
On fait de plus en plus d’albums enregistrés & mixés à Paris de façon analogique, travaillés comme à l’époque. On est sans cesse en train de s’améliorer d’albums en albums sur la qualité du son, celui-là mais aussi ceux à venir, il y a une nette progression.
Vous essayez de développer cette production maison ?
On travaille de cette façon depuis pas mal de temps, le premier album 100% analogique et de studio était celui de Mr Day en 2007, on continuait de travailler comme ça avec les artistes maisons – Lucas Arruda et son troisième album, Andre Solomko, et Aldorande, leur premier. J’en oublie surement dans la liste … Cotonete, c’est notre première collaboration, Al Sunny que l’on vient juste d’enregistrer, tout comme le nouveau maxi de Leroy Burgess que l’on est assez fier d’avoir mis en boite. Tout ça a été fait comme dans le temps, en essayant de se rapprocher des productions que l’on aime bien de la fin des 70’s au début des 80’s, quand il existait un vrai savoir-faire sur l’enregistrement & le mix. On arrive à un truc qui est vraiment pas mal, et c’est bien de le mettre en avant.
Les gens arrivent à entendre la différence, ils ne sont pas sourds. On est dans un niche, les gens qui nous suivent ont déjà bien digéré toutes ces productions. Je pense qu’ils apprécient l’évolution du son dans nos sorties.
C’était quelque chose que tu visais, dès les débuts du label ?
Oui, mais financièrement ce n’était pas possible de le faire. On est plus à l’aise maintenant pour monter des projets mieux ficelés. Et l’expérience. Toutes les erreurs sur les albums sur les précédents ont été en partie effacées, et il y a un progrès d’année en année.
On essaye de capter au maximum l’énergie, il faut que ça reste court. Et c’est un budget, quand les sessions sont longues. Pour cela, il faut de bons musiciens, qui se connaissent entre eux ou qui ont déjà répété ensemble. De très bons musiciens t’aident à faire un bon album. C’était le cas à l’époque, les gars restaient un minimum de temps en studio parce que cela coutait très cher, et c’était les mêmes gars que l’on retrouvait sur l’album de l’un puis de l’autre.
Ça a aussi son importance de travailler avec des musiciens qui ont l’habitude, qui ont fait de la scène et qui sont carrés.
Est-ce qu’il en existe encore, des « purs » musiciens de studio ?
Non, mais on est une bonne équipe qui se connait depuis longtemps, avec des musiciens qui ont progressé depuis des années. Ils ne peuvent pas se considérés comme uniquement musiciens de studio, mais ils ont le talent et la capacité de l’être. Sauf qu’à Paris, il y a très peu de demandes et puis dans la production actuelle, des groupes qui enregistrent de façon organique, il y en a très peu.
Comment se sont faites les rencontres avec des artistes « maisons », Lucas Arruda ou Cotonete ?
J’avais fait un truc d’un duo brésilien qui s’appelait Modo Solar. Ils étaient à Sao Paulo, un son jazz-funk un peu boogie, très 80’s de la scène brésilienne. Ils avaient envie tous les deux envie de faire un album après le quatre-titre déjà sorti. Mais le temps a passé, ils avaient d’autres préoccupations mais ils m’ont dit qu’ils connaissaient quelqu’un, un mec à Rio qui s’appelle Lucas Arruda. Il existait quelques courtes demos sur Soundcloud, j’ai trouvé ça super. Ça a été le point de départ de notre rencontre, ces quatre titres qu’il a fait évoluer en vrais morceaux. Là, on a fait le troisième album et il est en train de se préparer mentalement et physiquement pour un quatrième, voir ce qu’il voudrait faire. C’est prévu pour fin 2020, début 2021.
J’aime bien l’idée de ne pas arriver trois ans après un album. C’est court un an ou un an et demi si l’on compare à nos standards actuels. Ce que faisaient les groupes fin 70’s, début 80’s, enchainer un album tous les ans. Ce n’est pas simple pour tout le monde mais quand c’est possible, la sortie dynamise systématiquement l’album précédent et les autres, et puis trois ans c’est long. Tu peux vite être oublié, sauf si ton album a très bien marché.
On vise de pouvoir faire des vraies tournées en Europe, pour l’instant il est limité au Brésil. Pour le suivant, on aimerait bien le soutenir sur même cinq-six dates, marquer le coup. Il n’est jamais venu en Europe.
Ah bon ? je pensais que oui.
Beaucoup de brésiliens ne sont jamais venus en Europe, non. Ils ne voyagent pas beaucoup en fait. Ils ont tout chez eux, à part la montagne (rires)
Tu t’y es rendu plusieurs fois ?
J’y suis allé deux fois oui. Donc oui, l’idée est de ne pas attendre longtemps entre les sorties.
J’ai l’impression que c’est une ligne directrice du label, d’enchainer les sorties très rapidement.
Un peu trop même, je ne te cache pas que cette année est presque trop remplie. Il nous reste encore cinq sorties (la discussion s’est faite début septembre, ndr), plus les huit d’avant l’été, c’est complètement irrationnel (rires).
Est-ce que c’est la plus grosse année en terme de sorties ?
On en a eu des comme ça avant, mais c’est difficile de décaler les projets. Sur la suite, on essayera de ne pas dépasser les huit, neuf disques. Même si les rééditions ne nécessitent pas autant de travail de promotion, c’est quand même prendre du temps avec les artistes en développement pour les accompagner, pour ne passer directement passer à la suivante une fois le disque sorti.
Si l’on revient aux débuts, est-ce que tu te souviens de la toute première sortie ?
C’était en 2005, toute première sortie Favorite : un EP de Lee McDonald, une réédition. Avant ça, je faisais de la musique avec Mr Day sur un label qui s’appelait Glasgow Underground à la fin 90’s et début 00’s. J’avais au même moment mon premier label, Rotax, orienté house mais avec des disques jazz-funk, broken. On avait fait avec Mr Day donc, une reprise du morceau de Lee McDonald, « Gotta Get Home ». Un truc soul du New Jersey, hyper obscur, enregistré en 81. Mais avec un son fin 70’s. Le hasard a voulu que ce morceau ait été compilé dans une disque du Park Hyatt Tokyo, l’hôtel où a été tourné en partie Lost In Translation. Il était tombé sur cette compilation et avait aimé la reprise. Il est rentré en contact avec moi, fan du mec et du morceau.
L’album officiel a été réédité ensuite, mais le premier maxi est celui-là, We’ve Only Just Begun. Ron Foster, le producteur, qui était aussi le clavier de Ectasy, Passion & Pain avec Barbara Roy et d’autres formations, c’était vraiment un arrangeur d’orchestration. Un bon musicien, très bon clavier. Et je lui pose la question : « Est-ce que tu aurais encore les multi-pistes des trois morceaux, de l’époque ? » Et il me dit « des trois non, mais de « I’ll Do Anything For You » et « We’ve Only Just Begun » oui. » Je lui ai dit que j’avais envie de lancer une nouvelle aventure et je trouvai ça mieux de changer de nom de label, de commencer sur quelque chose de nouveau. Je lui ai proposé de faire les versions originales et des versions encore unreleased, arrangées avec des violons, plus des remixes puisqu’on avait les pistes séparées. J’ai demandé à Quantic qui buzzait bien à l’époque mais le timing n’a pas été bon. Finalement, c’est TM Juke, producteur à l’époque d’Alice Russell. Ça a commencé comme ça.
Je suis allé dans le New Jersey parce que je ne pense pas qu’il m’aurait lâché les bandes comme ça, on ne s’était jamais rencontré. Il y avait une certain méfiance, ce qui est normal. J’ai pris un billet d’avion et j’ai atterri dans une convention de soul où il y avait les Mondry, Barbara Mason, dans une université pas loin de Philadelphie. J’avais rencontré ses potes aussi, ça fait de supers souvenirs.
https://youtu.be/YPUspykCwsY
J’allais te poser la question de pourquoi changer de nom, mais j’ai ma réponse.
C’était l’impulsion oui, la rencontre avec Lee McDonald. On a commencé par faire donc l’EP We Only Just Begun, deux maxis de remixes, I’ll Do Anything For You, leurs remixes et par la suite l’album complet, Sweet Magic.
Est-ce que ça s’est passé la plupart du temps comme ça, où tu dois te déplacer pour récupérer les pistes ?
Les multi-pistes, c’est rare. Parmi toutes les rééditions que l’on a faite ces dernières années, très peu de producteurs avaient les multi-pistes. On favorise quand même l’artiste : c’est parfois très compliqué, les affaires entre les artistes et les labels car certains n’ont pas forcément été payé. On a tendance à aller directement vers l’artiste quand on est pas certain de qui détient les droits. Et ces dernières années, on est parti de très peu de master. On prend alors une copie vinyle de bonne qualité : au fil des années, je me suis équipé d’un système son hi-fi très très haut de gamme pour pouvoir faire des acquisitions au top, enlever les bruits de surface et les clics manuellement au mastering, on arrive à des résultats vraiment bluffants. À condition que l’enregistrement du vinyle soit de bonne qualité.
On aimerait avoir les masters plus souvent, oui.
Et sur les compiles, tu y arrives un peu plus ?
En général, on est à 20% de morceaux d’une compilation qui sont issus des masters. Sur la prochaine, sur 13 titres, on a pu récupérer deux masters seulement.
Et est-ce que tu arrives à mettre la main sur tous les morceaux voulus ?
Oui. Je ne peux pas compiler un morceau si je ne l’ai pas digéré moi-même. Ça veut dire que je l’ai. Toutes les compilations viennent de disques que j’ai, oui. Et idéalement, si je n’ai pas une copie en super état, je fais tout pour récupérer la copie la plus clean possible.
Dans cette recherche là, j’imagine que tu dois avoir des anecdotes assez croustillantes des musiciens & des artistes ?
Eux, ils ont toujours plein d’histoires croustillantes à raconter oui. Ils sont tous issus de la scène fin 70’s-début 80’s, quand l’industrie musicale était, je trouve, bien plus féroce qu’aujourd’hui, dans le sens où les musiciens étaient très très dépendants des maisons de disques. Un mec qui est ambitieux, qui a du goût et fait du bon son de nos jours, il peut se débrouiller tout seul en postant sa propre musique via les réseaux sociaux.
À l’époque, si tu voulais mettre un pied dans la musique, il fallait être signé sur une major, ou un gros indé. Ils étaient beaucoup bridés, n’avaient pas forcément le final cut sur leur propre musique. Donc oui, il y a pas mal d’anecdotes, de choses qui se faisaient et qu’aujourd’hui, n’importe qui se ferait descendre très vite sur les réseaux ! C’était un cercle bien plus fermé, et les gens en ont profité. Les artistes étaient demandeurs et les labels avaient le pouvoir.
Un artiste sur une compile AOR nous racontait qu’à l’époque, ils avaient mis de l’argent pour faire leur propre 45T, tout était financé. Et si tu ne passais pas sur les radios, les disquaires n’achetaient pas ton disque, tout simplement. Les mecs n’avaient pas anticipé ce paramètre et surtout celui d’être face à des radios qui demandaient de l’argent pour passer le disque en question. Tu pouvais payer en cash, mais la plupart du temps, les mecs voulaient de la coke en fait. Ça fonctionnait comme ça, on est vraiment des enfants de coeurs de nos jours ! (rires)
Il y’a quelques jours, j’échangeais avec Etienne, patron de Secousse Records. On parlait de rééditions et des labels phares comme Numéro Group ou Light In The Attic et il m’a dit qu’il y avait « des bons et des moins bons ». Tu le vois comment toi, cette scène de la réédition ?
Je trouve qu’on a été pas mal étouffé ces dernières années par des tonnes de rééditions et je suis quand même plus dans l’idée d’aider l’artiste local, faire de la découverte. Finalement, la réédition, ce n’est que du copier-coller. Il n’y a pas une importance énorme dans l’artistique, mis à part le choix des morceaux dans une compile. Des gens le font bien, d’autres le font à l’arrache, et ceux qui le font bien sont ceux que tu as évoqué, Numéro Group et Light In The Attic. Le son est au top, et il y a un vrai travail de recherche.
Les majors ressortent des disques sans arrêt et sans intérêt : le pressage original est à 5 euros sur Discogs, je ne vois pas l’intérêt de remplir les bacs de rééditions mal faites, en partant souvent du fichier CD, pour un résultat moins bon et plus cher. C’est pour inonder les magasins et faire du volume. Ils ne font parfois même pas l’effort, sur les éléments graphiques et les pochettes, de le faire correctement. C’est flou, mal scanné, ça pollue les magasins et c’est inutile.
Sur les visuels justement, j’imagine que tu as développé un oeil que tu as mis en place sur les pochettes des compiles notamment ?
Il y a toujours un point de départ, un détail que j’aime bien sur une pochette par exemple, des clins d’oeil. Sur les French Disco Boogie Sounds, on a fait des séances de studio à chaque fois : avec un photographe, mannequins, coiffeuse et maquilleuse, à l’ancienne. C’est bien moi, là (rires). J’ai commencé à faire ça pour le première volume, et je me suis dit qu’il fallait continuer.
Sur les compiles AOR, j’aime bien que ça soit simple, dépouillé. Il y a un lien entre les volumes. Pour les maxis Favorite, chaque année a sa pochette générique différente. On a des gros vendeurs, des disques que l’on represse régulièrement et qui ne sont plus conditionnés dans la même pochette que le pressage d’origine. On peut distinguer l’année du repressage.
Pour les rééditions, est-ce que cela t’arrive de changer un détail de la pochette originale ?
Non, je m’y tiens, au détail près. On arrive toujours à trouver une pochette en bon état, et on le soigne, on réécrit tout. Pour avoir un maximum de précisions, pour qu’elle ait l’air originale.
Il y’a eu deux cas de figure où j’ai du changé quelques petites choses. C’était le cas pour l’album de Arian, un musicien serbo-croate qui avait enregistré son disque à New York et dont l’album avait un minutage par face assez élevé. Les deux plus gros titres étaient en fin de face et vu que les DJs étaient très intéressés par ces morceaux, j’ai transformé un simple LP en double. J’ai dû changé le tracklisting sur la pochette. L’autre était pour le Junior Byron.
À l’époque, il y avait un vrai savoir sur le mastering, qui n’est malheureusement plus d’actualité. C’est très difficile de trouver des mecs qui peuvent graver comme avant. On pouvait avoir 22 minutes par face, avec un gain très honnête tout le long, ce n’est pas possible aujourd’hui. Il y aura forcément des problèmes de gains, de patate, et même de brillance et de grave. Plus on rajoute de minutage par face et plus l’ingénieur du son est obligé de resserrer les sillons, et très peu sont capables de faire sonner ça.
J’aurai pensé qu’au vu de l’amélioration de la technique, le rendu serait meilleur.
Le format vinyle s’est écroulé après la grosse vague house & hip-hop des 90’s, les DJs sont passé au digital, en Serato, sur CD puis sur clés USB. Du coup, il y a toute une industrie qui s’est cassé la gueule. Beaucoup d’ingés ont quitté les studios et il n’y a pas eu de transmission de savoirs.
Tu as dû voir cette évolution au jour le jour, notamment avec ton précédent label Rotax.
J’ai commencé en 95-96 et oui, on vendait énormément de vinyles parce que c’était le seul format qui existait. Les DJs n’achetaient que ça, les FNAC et grands magasins étaient remplis de bacs de vinyles. On avait encore un vrai savoir-faire, notamment en Angleterre. J’y allais à l’époque, on avait moins de fréquence dans les sorties donc on pouvait se permettre de faire des aller-retours. Et puis surtout, chaque sortie vendait 3 à 4 fois plus que maintenant.
Tu les vendais beaucoup moins cher aussi. C’est intéressant aussi à voir ça, le prix du vinyle a quasiment triplé depuis les 90’s. Il a augmenté logiquement par rapport aux quantités : un disque coûte toujours aussi cher à fabriquer, les frais sont quasiment les mêmes proportionnellement à l’époque et on en vend bien moins.
Un contre-exemple est l’album de Nu Guinea, que nous avons en distribution. On n’a jamais imaginé une seconde qu’on allait dépassé les 15000 exemplaires en vinyles ! (rires) Pour faire le lien avait ce que je disais, il y a quand même des albums qui dépassent la barre des 10000 mais ce sont vraiment des ovnis. Il y a truc qui s’est passé avec Nu Guinea, c’est complètement irrationnel. Musicalement c’est top, cela faisait quelques années qu’un très bon album italien n’avait pas surgi et le fait que ça soi napolitain donne un côté exotique. On en represse régulièrement, et c’est toujours en rupture.
C’est une bonne façon de fonctionner pour vous, la précommande ? Ça doit limiter les stocks et les invendus.
Vu les délais de fabrication, c’est difficile d’anticiper le nombre d’exemplaires. La précommande aide à mieux estimer tout ça, même si beaucoup le font au dernier moment. Mais ce sont des bons problèmes ! Je préfère en presser 500 et en vendre 2000, que l’inverse. On est dans une niche, les gens vont attendre ou même spéculer. C’est le cas pour Nu Guinea, qui est un groupe récent mais dont les gens s’arrachent presque les premiers pressage comme une réédition. Comme un Mylène Farmer (rires).
Comment tu as vu l’arrivée du numérique et les changements de consommation ? Est-ce que tu as tout de suite réagi et adapté ton modèle ?
C’est comme ça que je suis devenu distributeur ! (rires) Je ne suis pas resté comme ça à regarder et me trouver à la rue ! Il a fallu réagir, et c’est à ce moment là que j’ai monté The Pusher Distribution, vu que l’on vendait de moins en moins. Le retour du vinyle n’est pas si vieux que ça, cela fait quatre, cinq ans que ça repart. Étant dans une niche, je partais toujours du constat qu’il y aurait bien 2000 tarés près à acheter mon disque dans le monde, à condition que le disque soit bien fait.
Ça a été un super moteur et ça nous a relancé. Ça m’a poussé à augmenter les labels dans le catalogue du distributeur, accélérer la cadence de sorties pour proposer plus de choses à nos clients. On travaille avec près de 250 magasins à travers le monde à présent. Même en Australie, à Séoul, en Amérique Latine. Donc ça fait du sport !
J’ai commencé tout seul en 2005 à la création de Favorite jusqu’en 2012. J’ai travaillé comme un dingue pendant toutes ces années, Vince m’a rejoint en 2012 et Maxence nous aide ces temps-ci. On arrive à faire à deux, trois personnes ce qui nécessitait avant, dans un label classique, une équipe de dix. C’est beaucoup de boulot, mais on veut rester petit et on s’améliore au fur et à mesure des années. On progresse toujours, c’est encourageant !
Favorite Recordings
The Pusher Distribution