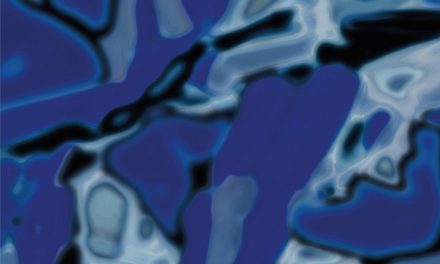Forte d’un second album ambitieux, Jbal Rrsas qui trace une ligne claire entre musiques clubs occidentales et héritages orientaux, la productrice et DJ Deena Abdelwahed poursuit l’exploration méticuleuse de ses instincts. Rencontre avec l’artiste, avant son concert-événement à La Gaîté Lyrique, ce jeudi 15 février.
Un débit mitraillette, entrecoupé de longues pauses pour trouver ses mots, ou plutôt les mots justes. Assis dans le café d’un cinéma du nord de Paris, seuls parmi les affiches des films qui défilent sur des écrans autour de nous, on rencontre Deena Abdelwahed – affable, souriante et enthousiaste sur son live, « sa performance » nous précise-t-elle, à venir dans la grande salle de la Gaîté Lyrique. Elle est enrhumée, mais ça va. De retour d’un séjour aux États-Unis, elle nous raconte ses trouvailles sur place et revient sur la conception de son second album magistral, Jbal Rrsas, magma électronique de musiques orientales qui ne fait pas de clins d’œil à ses influences mais crée un nouveau langage, une nouvelle musique qui fait bouger des montagnes, à l’image de la pochette de son disque.
Comment vas-tu ? Tu es de retour des États-Unis, comment était ton séjour ?
Ça va très bien, de retour à Paris ! J’ai passé un mois et demi aux États-Unis avec la Villa Albertine. C’était une résidence d’exploration autour d’un sujet que je souhaitais investir autour des musiques contemporaines et des communautés afro-américaines.
Lorsque que l’on parle de musiques contemporaines – dans son sens global, elles sont basées et inspirées des musiques afro-américaines – de la disco à la techno jusqu’à la trap. Je voulais comprendre, pas de façon historique mais plutôt d’un point de vue environnemental, sociétal, qu’est-ce qu’il fait que les innovations des ces artistes-là, les afro-américains et leurs musiques, qu’est-ce qu’il fait qu’elles soient propres à eux ? Ils puisent autour d’eux, leurs inspirations restent leur environnement. Ce qui est fou, je trouve. Si vu d’ici, notre boussole musicale est les États-Unis, où est leur boussole, à eux ?
J’ai choisi Atlanta et New York pour ça – Atlanta pour la trap bien sûr, et New York pour ce qu’elle représente, là où les musiques sont écoutées et « validées » avant d’être reconnues ailleurs. Je voulais aussi voir les autres sous-genres de club music – Jersey, surtout. Jersey et New York, c’est d’ailleurs un peu comme Paris et Montreuil – tu habites à côté, c’est proche mais pas tout à fait. C’est une ville super chère, c’est très difficile quand tu es un.e artiste en devenir. Il n’y a pas de politique culturelle gouvernementale, de salle subventionnée, d’aide… Mais même dans des situations rudes, surtout pour des afro-américains qui est une catégorie très marginalisée de la population, les artistes s’épanouissent. Ici, avec toutes les aides et les conditions favorables, on doit sans cesse copier… Il y a un manque d’inspiration. Là-bas, c’est de la survie. On peut dire vu d’ici que c’est parce qu’il y a un manque de moyen que l’on se doit d’être inspiré. Je ne pense pas. Je sais que c’est logique d’analyser la situation comme ça, mais je crois qu’au contraire – s’il y avait aux États-Unis les mêmes modalités et les mêmes politiques culturelles qu’en Europe, les propositions musicales auraient été encore plus avancées. Et c’est là toute la question : ce n’est pas le fait d’être innovateur en soi, je ne crois pas que cela soit un acte de survie. C’est ce que j’ai compris, je pense que c’est le fait d’être en communauté, d’être proche, présent physiquement, et surtout conscient des générations qui étaient là avant. Ils (les artistes afro-américains, ndr) n’ont pas coupé les ponts avec les parents, grands-parents… Ici, en Europe ou dans les Pays Arabes d’ailleurs, c’est impossible. On te met du Charles Aznavour, tu vas dire « mmmh, non ». Alors que là-bas, ils écoutent encore du Aretha Franklin – et ils vont encore s’en inspirer. Je crois qu’il est là, le twist. Ce n’est pas les moyens, c’est un continuum de générations musicales.
Le but serait de prendre ses réflexions-là et de les mettre dans des compositions futures ?
Non, pas vraiment. Au départ, je voulais faire une vidéo – un documentaire presque. Puis, je me suis dit qu’une exposition serait mieux : avec des installations et plusieurs perspectives – pas que la mienne, pour permettre au public une réflection peut-être différente. Mais cela va m’influencer pour la suite, je pense. Cette histoire des générations, j’y pensais déjà et c’est un peu pour ça que je fais de la musique.

C’est quelque chose que tu as voulu mettre dans ton album, le côté transmission-génération ?
Pas de façon aussi directe, c’est plus abstrait. Quand j’ai commencé à faire de la musique, la motivation était qu’en Tunisie, de tout ce que l’on écoute dans un club et sur un dancefloor, rien ne reflète ce qui se passe au-dehors de ces quatre murs. Tout était de la techno, house… étrangère, anglaise. Je ne suis pas nationaliste, mais c’est quand même alarmant de ne rien avoir de propre à son environnement. Toute musique propre à notre environnement est considérée comme ringarde. J’en ai discuté avec d’autres musiciens et amis du monde arabe sur cette question. Il y a même un terme en égyptien qui désigne ça, et qui veut dire « le complexe d’être ringard ». Si l’on utilise quelque chose d’arabe pour nous exprimer, cela veut dire que l’on est pas cultivé, ouvert sur le monde, nationaliste… C’est ce qui m’a motivée à explorer la musique arabe comme je l’entends et je la vois. Ce n’est pas prendre des samples et le remixer, j’ai voulu aller dans le corps – faire de l’abstraction. Et pour faire de l’abstraction, il faut comprendre. C’est un voyage. Je ne savais pas comment le faire, et j’ai commencé à voyager. Cet album est celui qui représente le mieux ce voyage. Il est le plus fidèle à ce que je voudrais raconter.
Comment s’est passé la composition ? Est-ce que tu fonctionnes à l’instinct, ou tu fais beaucoup de recherches et de préparation ?
Les deux. J’ai fait beaucoup de recherches – pour rechercher de la musique égyptienne, libanaise, c’est plutôt facile. Il y a des forums où l’on trouve des tutoriels qui expliquent étape par étape comment faire de la dabke sur Fruity Loops ou Ableton, par exemple. En Afrique du Nord, non (rires) C’est pour ça que sur mon album, il n’y a qu’un morceau d’inspiration marocaine. Idem pour la musique du Golfe – Arabie Saoudite, Yemen et Qatar, elle n’est pas aussi référencée que la musique du Levant. Je voulais prendre pour soi les mêmes techniques et les appliquer sur des rythmiques différentes. C’était vraiment étape par étape ; j’essaye d’étudier, de comprendre et de reproduire les façons de faire. Dès que j’arrive à maîtriser la technique, l’instinct vient. L’idée n’est pas de copier à l’aveugle mais plutôt de me réapproprier. J’écoute le groove, la rythmique et j’essaye de comprendre pourquoi cela fonctionne et pourquoi j’ai envie de danser. Les feelings, en quelque sorte. De cette façon, ce n’est pas une chanson pédagogique – elle n’est pas vide, elle a une âme. Et la musique arabe est, pour simplifier, très intuitive.
Finalement, c’est plus proche de la musique club et de la techno que de la musique folklorique. C’est le même moteur, c’est aller vers une transe – pas dans le sens religieux, plutôt accorder son inconscient avec la musique, d’être sur les mêmes ondes musicales. Il y a tous ces états d’être dans l’album. Et ce n’est pas encore fini : le live est la prochaine étape.
Justement, comment construis-tu le live ?
Sur le précédent live et le précédent album, Khonnar, j’improvisais sur la structure de l’album. Je ne respectais pas l’arrangement – c’est du jazz, presque. Ici, on ne va pas toucher à l’arrangement, et c’est ce que j’avais en tête en studio ; je l’ai enregistré comme un live, en jouant sur le côté intuitif et sur l’intensité. C’était donc dommage de ne pas utiliser ça. Khalil Hentati, avec qui je joue en live, s’occupera des mélodies et je m’occuperais des rythmes, de l’énergie globale du morceau et de ma voix. Côté visuel, j’ai rencontré Niculin Barandun pendant une résidence au Caire où l’on a fait un concert ensemble. J’étais très à l’aise, j’ai beaucoup improvisé (rires) mais tout s’est bien passé. J’ai décidé de lui faire suivre mon album qui lui a plu, et on va travailler ensemble sur scène.

Jbal Rrsas, le nom de ton second album, est le nom d’une chaîne de montagne en Tunisie – mais on la voit déformée, remodelée. Quel est le symbole derrière ?
J’avais décidé que la pochette serait la montagne, brute. On est parti avec le photographe Yassine Meddeb Hamrouni, on a pris des images tout au long de la journée et selon la lumière, il y avait d’autres couleurs, d’autres angles – elle change tout le temps. J’aime beaucoup cette montagne. J’ai proposé à Niculin de modifier une des photos, c’était une façon de mettre en avant son travail et d’insister sur la performance. Jbal Rrsas est un projet de performance.
Deena Abdelwahed sera en concert ce jeudi 15.02 à la Gaité Lyrique.
Jbal Rrsas (InFine)
crédit photos: Yassine Meddeb Hamrouni