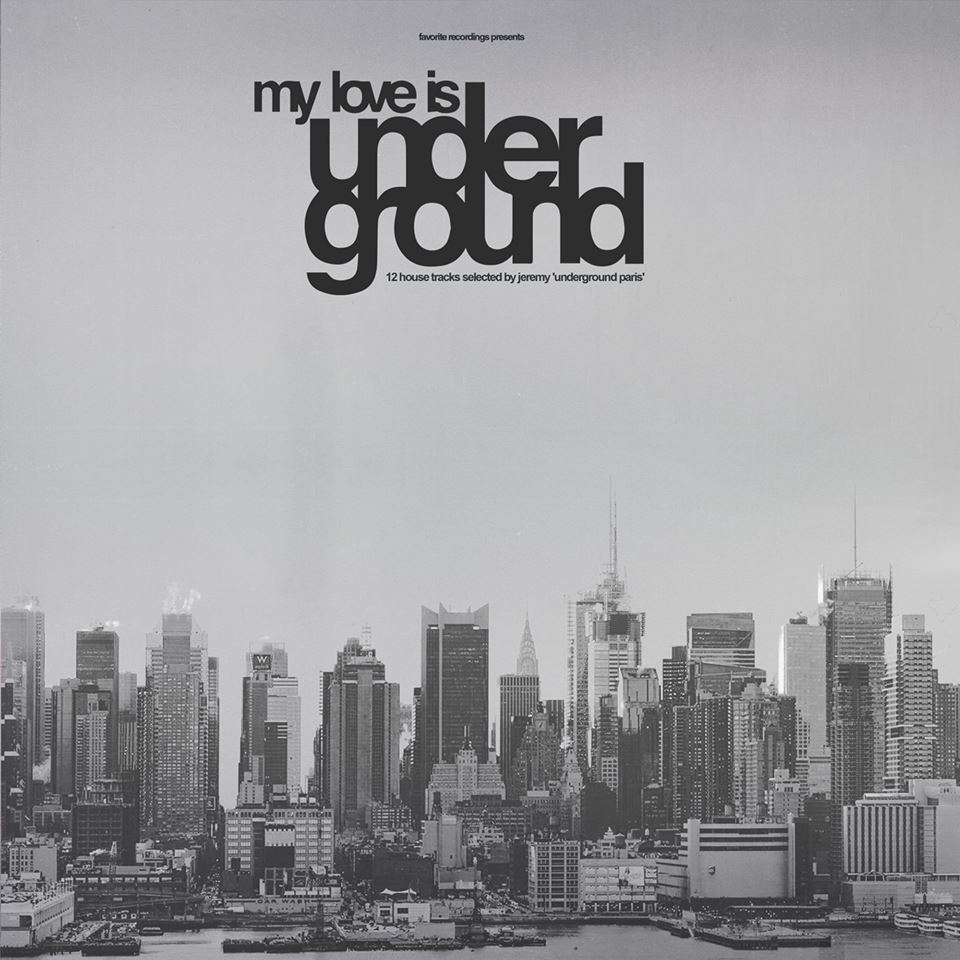S’il y a bien un endroit où peu de mélomanes, amateurs de musiques afro, ne repartent les mains vides, c’est au 53 rue de Nazareth dans le 3e arrondissement de Paris. La sélection du magasin allie les classiques incontournables de funk, de jazz et de soul aux perles rares de la « world music ». Cependant, le cheval de bataille de Superfly s’avère être le label affilié à l’enseigne, spécialisé dans la réédition de raretés oubliées, voire jamais révélées au grand jour. À l’heure où tout est de plus en plus accessible sans décoller de son clavier d’ordinateur, nous sommes allés à la rencontre de ces activistes du disque.
– Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, ainsi que le label et la boutique ?
Bonjour, je suis Manu Boubli. Avec mon associé Paulo, nous avons fondé Superfly Records. C’est à la fois un magasin exclusivement dédié aux vinyles neufs et d’occasion. C’est aussi un label qui réédite des morceaux introuvables pour les rendre de nouveau disponibles. Nous sommes trois à la boutique ainsi qu’une quatrième personne qui travaille avec nous sur le blog pour les interviews et la partie éditoriale.
– Quand avez-vous commencé à digger ?
Ça commence il y a environ 30 ans de ça. Au départ, on cherchait des disques parce que c’était marrant, ce n’était pas cher puis pour les passer dans les fêtes. Avec le temps, on s’est pris au jeu, il fallait trouver des sons toujours plus obscurs. On vient tous de la génération qui marque les débuts du hip-hop. On cherchait des vieux sons à sampler, des breaks de batterie… Au fur et à mesure, on s’est mis à digger de plus en plus profond, dans différents pays et encore aujourd’hui on découvre encore des choses nouvelles.
– Quel était le premier pays où vous avez commencé à digger en dehors de la France ?
Hormis les pays européens, car tu digg toujours là où tu voyages, le premier Graal où tu souhaite aller au départ, ce sont les États-Unis même si tu te rends compte par la suite que ce n’est pas forcément ce qu’il y a de plus incroyable – mais lorsque tu commences c’est un passage obligé.
– Récemment vous avez repressé un disque japonais, d’un joueur de Koto.
Entretemps, on a découvert plein d’autres choses qui sont au moins aussi bien que les disques américains, notamment les disques japonais, mais aussi le disques antillais, colombiens, cubains…
– Votre spécialité reste quand même la black music, non ?
Oui, même si on vient de deux points différents de la black music. Paulo vient plus du boogie, de la modern soul et du funk. Moi je viens plus du jazz, mais il y a de la bonne musique de partout: maintenant on écoute même du rock progressif. Il n’y a plus de limite.
– Il y a de la bonne musique de partout, mais peut-être pas tout le temps, avez-vous une période de prédilection ?
Je ne serai pas très original, mais je te répondrai entre 1965 et 1975. C’est la meilleure période pour plein de raisons notamment grâce à la liberté dans tous les sens du terme. Les gens prenaient de la drogue ce qui peut aider à être créatif, parfois. Mais ce n’est pas limitatif, on constate que dans les années 1980, plein de petits labels ont continué à sortir de la super musique qui n’était pas du tout connue ou médiatisée à l’époque.
C’est donc tout le boulot des diggers de retrouver ce genre de sons que personne n’avait trop capté à ce moment-là. Puis l’oreille change, par exemple, les sons de synthés qui ont été négligés pendant des années, car on était plus sur des claviers du genre Fender Rhodes , sont finalement ressortis, car on s’est rendu compte que les synthés c’est bien aussi. Les oreilles évoluent, tu évolues avec ton temps.
– Peut-on dire que l’âge abolit les clivages au final ?
Non, c’est juste qu’à force d’écouter du son tu fouilles plus profond et tu te rends compte de ce qui est vraiment bien. Par exemple, si on te fait écouter du zouk alors que tu ne connais rien à la musique antillaise, tu ne vas pas forcément aimer. Alors que si tu creuses ça peut t’amener par capillarité à des choses mortelles comme Tropical Discoteq qui en 2015 arrive à faire danser des gamins de 20 ans.
Sauf qu’il y a 20 ans ce sont des disques que tu n’aurais pas pu jouer, à part dans une soirée antillaise. Donc dans une soirée communautaire, pas dans une soirée branchée. Le temps fait avancer certaines choses et en reculer d’autres. A contrario, avant tu pouvais jouer du jazz dans des soirées du Festival de Cannes alors qu’aujourd’hui c’est plus compliqué.
– Ne penses-tu pas que cette ouverture est due à Internet et aux réseaux sociaux, qui ont favorisé le partage et l’accessibilité ?
Sûrement en partie, mais aussi parce qu’aujourd’hui lorsqu’une musique sort, tout le monde la découvre en même temps. Il y a un effet de tendance et de fraîcheur. Par exemple, si tu prends un disque de James Brown aujourd’hui même si c’est super, ça n’apporte rien de nouveau du tout, tout le monde s’en fout. Il y a les clients qui les ont déjà et les nouveaux qui préfèrent acheter quelque chose de plus frais. Ils y reviendront sûrement à un moment ou un autre, mais c’est cyclique.
– Du coup qu’est-ce qui vous pousse à vous lancer dans la réédition d’un disque ?
C’est assez simple, en général notre premier critère est de savoir si nous serions acheteurs nous deux. Si c’est le cas, il y a de fortes chances pour que 1000 personnes le soient aussi, donc on le represse. Jusqu’à présent, nous ne nous sommes pas trompés.
– Quand avez-vous décidé de passer à l’action, de rééditer un disque la première fois ?
De mon côté, je viens de la production, donc j’avais déjà cette expérience-là. Paulo, en avait l’envie. Lorsque nous nous sommes demandé comment nous allions communiquer sur le magasin, nous avons trouvé assez intelligent de monter un label, car c’est de la communication qui rapporte de l’argent, même si ça ne rapporte pas énormément. Tes disques sont dans des bons disquaires un peu partout à travers le monde, ce qui fait parler du magasin. On s’est pris au jeu et aujourd’hui, nous sommes motivés pour signer le plus de disques intéressants possibles, on en est au quinzième, ça va relativement vite, nous en sortons entre 4 et 5 par an.
– Vous distribuez-vous même ?
On fait absolument tout nous même, ce qui n’est pas une charge de boulot énorme sachant qu’il n’y a que mille exemplaires. C’est un peu la nouvelle économie du disque, il n’y plus besoin de distributeur car moins de disques sont édités. Avant, lorsque tu pressais 5000 ou 10000 copies, tu n’aurais pas pu le faire seul, mais pour 1000 exemplaires ce n’est pas un souci. Finalement, si nous avions un distributeur, les coûts se répercuteraient sur le prix de vente final et ce serait l’acheteur en bout de chaîne qui payerait trois euros à cinq euros pour rien. Sur ce genre de produit, la distribution n’a pas vocation à perdurer longtemps.
– Est-ce que ce processus de réédition est facile ?
Le point le plus compliqué est de retrouver les ayants droit. Lorsqu’on parle de disques obscurs du fin fond du Ghana, le problème c’est d’abord de trouver le mec à qui appartiennent les droits : avec qui signer le contrat ? Et après de savoir s’il a envie de signer le contrat. Ce qui n’est pas toujours le cas. Par exemple Voices of Darkness, un disque d’un camerounais enregistré au Ghana, ça nous a fait vivre des anecdotes. Franck Voodoo Funk, qui voyage au travers de l’Afrique avait rencontré ces camerounais et si l’on voulait rééditer le disque, il a fallait qu’on envoi un Western Union avant le lendemain matin pour avoir le contrat. Parfois, il y a des choses plus faciles comme pour Ebo Taylor car son manager est mon ancien associé sur le label que j’avais avant.
– Et d’ailleurs c’était quoi le label ?
C’est un label qui s’appelait Comet sur lequel on produisait Tony Allen, le batteur de Fela Kuti avec mon associé. Il est encore manager de Tony Allen aujourd’hui et d’Ebo Taylor entre autres…
– Vous avez déjà prévu une prochaine réédition ?
On en a trois de prévues, qui vont arriver assez vite. Deux débuts mars : Norma Jean, un disque de soul américaine de la fin des années 1960 et un disque de reggae nigérian qui s’appelle Shift Shaker. On va aussi éditer une nouvelle sortie japonaise qui s’appelle Flute Adventure, c’est assez progressif avec une très belle pochette.
– Il y a beaucoup de disques japonais qui valent une fortune ici et ne sont pas repressés alors qu’il y a une forte demande. Ce n’est pas compliqué de faire face à certaines différences culturelles au Japon ?
Justement, pour cette sortie on est typiquement dans cette configuration. Les Japonais le ressortent en CD, mais pas en vinyles, car leur marché est trop petit et ils n’exportent pas. Donc lorsqu’on represse des disques Japonais on en vend déjà 300 ou 400 au Japon, puis le reste dans le monde. Mais le Japon reste un bon marché.
– Avez-vous recours à des interprètes parfois ?
Non, pas forcément, on fait appel à nos contacts principalement. Par exemple, au Brésil on a un contact que l’on emploie pour chercher des disques et retrouver les ayants droits.
– Malgré la boutique arrivez-vous encore à voyager ?
Oui beaucoup, tu es obligé pour aller chercher des disques. Dans les années 1980, il y avait des gens qui t’apportaient des disques dans les boutiques, mais maintenant c’est fini. Tu dois aller les chercher. Mes associés reviennent des Antilles là par exemple.
– Quand avez-vous ouvert la boutique exactement ?
Novembre 2009 et le label en 2010.
– Pourtant ce n’était pas une période facile pour le vinyle.
Pour les nouveautés non, mais pour le vinyle de collection, d’occasion c’est quelque chose qu’on maitrise et on n’était pas spécialement inquiet. On connaît le marché et on sait quel disque vendre, il suffit d’avoir la bonne marchandise. C’est là toute la difficulté.
– Vous êtes donc sur une niche qui n’a pas connu la crise ?
Non, pas vraiment. Au contraire, c’est une niche qui ne fait que prospérer. Les disques rares sont de plus en plus chers. De nos jours, tu as même des gens qui investissent dans des disques comme dans les tableaux. Ils le voient comme un placement.
– Vous voyez cela de quel œil ?
Tout ce qui contribue à faire avancer le marché ne me dérange pas sur le fond. Il ne faut pas en abuser non plus, comme ceux qui achètent des disques que s’ils sont fermés et ne les ouvrent même pas. Normalement, la musique est faite pour être écoutée.
– Du coup, vous n’avez pas peur que le marché du vinyle devienne finalement un marché de souvenir ?
Tant que c’est dynamique, qu’il y a des DJ’s, des compilations, des rééditions et des nouvelles générations qui reprennent le flambeau, ça va. Le risque c’est de savoir s’ils seront toujours là. S’il n’y a plus que des collectionneurs, ça devient dangereux. Mais ça n’a pas l’air d’être le cas, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à acheter des vinyles de funk et des vinyles de house, car pour eux c’est de la musique ancienne. Ces jeunes sont frais et mettent de la dynamique. Ils ne sont pas dans une optique de collectionneur qui cherche la pochette parfaite.
– Et justement avez-vous remarqué la différence de public à la boutique ?
Oui bien sûr, en ce moment surtout. Est-ce que ça va durer ? Je me doute qu’il y en a pas mal qui n’en achèteront que 20 ou 30, une fois qu’ils les auront et que ça fera une bonne déco, ils arrêteront. Ce qui me rassure c’est que sur 100 personnes qui achèteront 30 vinyles, Il y en aura toujours 5 ou 10 tomberont accro au vinyle, c’est un truc de junky.
– De quel œil voyez-vous Discogs ?
C’est un moyen de vendre des disques comme un autre. On vend sur Discogs. Il ne faut pas cracher dans la soupe et dire que c’était mieux avant car c’était quand même dur de vendre des disques. Discogs c’est un outil supplémentaire pour vendre, donc c’est pas mal. Il faut juste le prendre pour ce que c’est.
– Est-ce que cela ne contribue pas fortement à la hausse des prix ?
Je n’en suis pas sur. Ça contribue à ce que tout le monde vérifie, même si ce n’est pas forcement le meilleur indicateur de prix. Ça peut aider à savoir si un disque est rare, lorsqu’il y en a 50 en vente sur Discogs, tu sais qu’il n’est pas rare. Ça permet aussi au client de savoir si tu es chez un disquaire sérieux ou s’il vend les choses à leur juste prix. Si tu es trop cher, tu ne vends pas tes disques.
– Du coup vous alignez-vous sur le prix du marché de Discogs ?
Pas forcément, Discogs, mais plus de Popsike, c’est un site qui reprend toutes les enchères Ebay par date et nous permet de comparer les ventes pour aligner nos prix. Une enchère n’est pas significative cependant lorsque tu en as 15 tu peux faire une moyenne, qui a du sens. Il n’empêche que ce n’est pas parce que j’ai cette côte que je ne vais pas vendre un disque plus cher et inversement, ce n’est pas parce que j’ai un disque très cher que je vais le vendre aussi cher que la côte sous prétexte d’un effet de mode. Je viens d’une époque où tu allais chercher des disques à NYC à 1 dollar, tu pouvais les vendre 500 francs à Paris même s’ils étaient en mauvais état. Ce n’est plus possible, c’est plutôt cool.
– Pourquoi avez-vous dû arrêter vos anciens labels ?
Car la production de disque actuelle est très compliquée. Les nouveaux disques sont très durs à vendre. La réédition se vend, mais dès qu’il s’agit d’un disque actuel ça devient compliqué. Peut-être, car il n’y a plus de mouvement novateur. La soul et la house qu’on écoute aujourd’hui sont des revivals de ce qu’on écoutait avant, c’est fait «à la façon de». Aujourd’hui, faire de la production, c’est bien si c’est pour le cinéma, la télé, la pub. Je le faisais un peu, mais pas assez.
– Donc le conseil pour monter un label finalement est-ce de faire dans la réédition ?
Le conseil pour monter un label, c’est de faire ce en quoi tu crois vraiment. Je suis dans les vieux disques depuis toujours donc j’y crois et je connais ce truc-là. La production c’est une autre histoire, c’est dur d’en vivre correctement même s’il y a des labels qui marchent.
– Le label n’est-il pas devenu une vitrine plus qu’autre chose ?
Oui, par exemple, j’ai un pote qui a sorti son disque et le donne en promotion pour faire venir du monde à ses concerts. C’est vrai que la musique aujourd’hui ne s’achète plus vraiment, pour les jeunes c’est censé être gratuit. Personne n’achèterait le dernier titre de Pharrell Williams, tu le télécharges et tu le mets sur ton téléphone. La musique actuelle est vouée à être gratuite à un moment ou un autre.
– Vous essayez d’inculquer votre passion à vos enfants ?
Je n’essaye pas, en général, c’est toujours pareil, pour t’affirmer t’as besoin d’aimer tes propres musiques puis au fur et à mesure tu te rends compte tout est relié par des ponts. J’ai quatre enfants donc je pense qu’il y en aura toujours un qui récupérera les disques un jour ou un autre.
– Vous avez prévu quelque chose pour le Disquaire Day ?
Nous allons faire quelque chose à la boutique, même s’il y a beaucoup de monde et pas beaucoup de place. Il y a énormément de passage, notamment des gens qui n’achètent des disques que ce jour-là. Je suis partagé quant à cette événement. Je ne peux pas dire que ce n’est pas réussi, car la communication est très bien faite, on en parle même au journal de vingt heures. Ce que je trouve dommage c’est qu’il n’y ait aucun suivi sur l’année et que les organisateurs ne consultent pas les disquaires pour choisir les disques qu’ils sortent. Pourquoi represser du Mylène Farmer ou du Johnny ? C’est un peu récupéré par les gros du business, c’est inévitable, mais il pourrait y avoir plus de bons disques.
– Vous aimez avoir ce rôle de conseil en boutique ?
On laisse les gens faire. Si on me demande, je conseille avec plaisir bien sûr. Mais au début nous ne sommes pas interventionnistes. J’ai toujours aimé être tranquille quand je rentrais dans un disquaire. Après, c’est bien d’avoir des conseils.
– Et du coup, si je vous demande cinq vinyles à me conseiller, qu’est-ce que tu me dirais ?
Merci à Manu pour le temps qu’il nous a accordé. Retrouver Superfly Records sur leur site internet ou sur leur page Facebook.